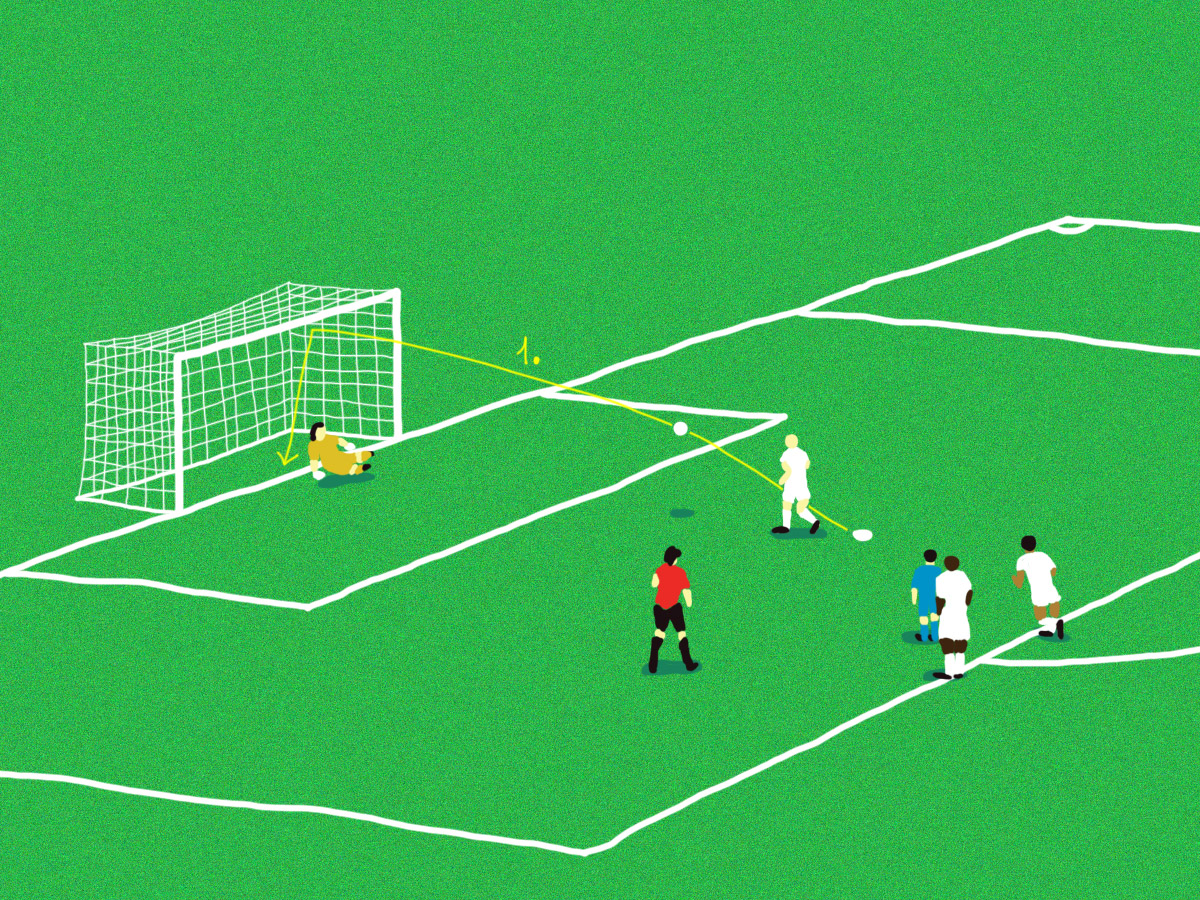Par Ludovica Anzaldi (artiste) et Hugo Do Peso (rédacteur)
Au vu de la passion médiatique que déclenchent les révélations sur le harcèlement et la condition des femmes dans le monde, il semble judicieux de s’arrêter sur le sens des mots et sur les manières de prendre la parole afin d’éviter tout contresens ou jugement trop hâtif. Si la société recèle autant de drames et de crimes que le montre cette libération de la parole, il faut apprendre à écouter, à comprendre et à compatir pour savoir quoi changer. Et donc à laisser vraiment parler celles qui ont des choses à dire.
The Silence Breakers, ces femmes qui ont osé dénoncer le harcèlement sexuel et les agressions qu’elles ont subies, et que Time Magazine a couronné personnalités de l’année, ont rappelé à notre société de l’hyper-communication que la parole humaine, intime, sincère, contenait encore beaucoup de pouvoir. Les mots « balance ton porc » ont fait craindre à quelques-uns un mouvement de dénonciation massif qui reviendrait à mettre autant d’hommes au pilori sans le temps du jugement. Les témoignages se bousculent, certaines failles sociales se révèlent lentement et un débat sur le crédit à leur porter émerge. Le récit seul ne peut évidemment pas se substituer au procès, mais pour beaucoup de femmes la justice n’a rien pu ou voulu faire pour justement se rendre attentive. Dissuasions, pressions hiérarchiques, complexité de la procédure ou manque de force psychologique sont autant de critères qui font qu’on ne peut pas contraindre une femme agressée à s’engager dans un combat administratif qui peut lui être défavorable. Pourtant, certaines et certains déplorent ce mode d’expression parallèle des mouvements #metoo et #balancetonporc et assimilent la libération de la parole tue à sa perte de légitimité. Maya Khadra, journaliste, estime que #balancetonporc « repose sur les bases d’une violence verbale hargneuse » et que si une femme souhaite simplement disqualifier un homme qu’elle n’aime pas, cela « conduit nécessairement à ce que la tyrannie change de camp ». Le scandale serait donc sur la forme des révélations et non leur contenu.
Ces réflexions évitent donc la question de la condition féminine et déportent l’enjeu sur un autre sujet. Le monde des réseaux est depuis son émergence un monde du harcèlement et de la dénonciation. L’année dernière, une étude britannique de l’association Ditch the Label a estimé que plus d’un jeune sur deux avait déjà été harcelé ou humilié sur les réseaux sociaux. La viralité et l’efficacité des plateformes sont redoutables : une photo, un simple message, et quelle que soit la véracité de l’information, le mal est déjà fait. Cela est parfaitement indépendant du contenu, qu’il s’agisse d’un témoignage de victime ou de l’insulte du harceleur. Post-vérité, fake news et ré-information sont des termes qui prennent de plus en plus de place dans notre société ; d’autre part, la vie privée devient une source de données commercialisables, un atout de self-branding, une création publique que l’on donne à voir. La youtubeuse Marion Seclin est justement intervenue au cours d’une conférence TED1 pour raconter son histoire de harcèlement hors-norme suite à ses engagements féministes. Ces événements nous amènent donc logiquement à repenser la fonction de la parole contestataire aujourd’hui : pourquoi certains préfèrent croire de grossières rumeurs simplement parce qu’elles sont virales, alors que d’autres n’accordent ni confiance ni crédit aux récits d’agressions diffusés sur les réseaux sociaux ? N’y a-t-il pas un « droit à la victimisation », qui assure à celle qui se dit victime que l’on puisse écouter ce qu’elle a à dire ?
Il faut une fois pour toute définir « harcèlement »
Le harcèlement sexuel est défini en France par la loi depuis 2012. Il « se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le principe même de la loi est de contraindre des mots à porter un sens suffisamment clair pour garantir le jugement, de manière neutre, impartiale et objective. L’étymologie nous rappelle ainsi que lire et légiférer sont historiquement les mêmes mots. Les critères en question pour définir le harcèlement sont donc ceux-ci : la contrainte (psychologique, comme l’ordre, la menace ou la crainte, et/ou physique), la répétition (qui contextualise le geste du harceleur, qui pose une situation et non plus une exception ou une erreur), le propos sexuel (proposition de rapport sexuel, questions intimes, blagues salaces et vulgaires sur la personne), l’atteinte à l’intégrité (sentiment d’humiliation, de saleté, de rabaissement) et l’intimidation (le fait que la personne n’ose pas réagir immédiatement par le fait même de la contrainte exercée). Le critère de la répétition n’est pas nécessaire quand il s’agit d’un acte obscène ou d’une demande de relation sexuelle avec pression psychologique quand la personne a déjà exprimé son refus. De plus, la présence d’un contact physique jugé offensant et non désiré qualifie le harcèlement en agression. Un délai de 6 ans est garanti avant prescription des faits, ce qui laisse la possibilité de changer de travail, de mieux comprendre avec le recul la raison du mal-être, ou même d’attendre de se rallier à d’autres victimes du même harceleur. La définition est sans ambages : voilà précisément ce que dénoncent les « briseuses de silence ».
La contestation des anti-féministes tente de subvertir cette définition claire en supposant que les dénonciatrices élargiraient le champ du délit à la « drague lourde ». Tout un nouveau lexique fleurit alors : esprit français, donjuanisme, grivoiserie et surtout gauloiserie. Philosophie Magazine de mai 2009 définissait la gauloiserie comme « un des six sommets de l’Hexagone », associé à la galanterie. Ce serait une forme de désinvolture, de malice dans la séduction. L’ancienne ministre Christine Boutin donnait sur LCI en 2016 sa propre définition : « Le harcèlement sexuel, c’est plusieurs répétitions. C’est pas le fait de dire ‘raccourcis ta robe’, ‘mets-toi à poil’, ‘t’as de beaux seins’. Franchement, c’est pas ça, ça fait partie de la grivoiserie. » et la veille sur RMC « Moi personnellement, j’aime bien la gauloiserie. Je trouve que le problème du harcèlement, c’est de savoir quelle est la limite. » Pourtant, non seulement la limite est fixée par la loi mais en plus, certains propos sont des causes, des déclencheurs de la situation. La démarche de Mme Boutin à l’époque, face aux 17 femmes politiques qui avaient déjà signé une tribune dans le JDD2 contre l’impunité des harceleurs, est motivée par une peur, celle de voir un modèle de séduction disparaître.
Le mythe de la pensée à l’américaine
Cette tentative de subversion du sens de « harcèlement » prend appui sur un anti-modèle absolu : les rapports femme-homme à l’américaine. Dans l’imaginaire français, quelques clichés sur les moeurs outre-Atlantique reviennent : l’interdiction pour les hommes de prendre l’ascenseur seul avec une femme (ou alors l’homme qui n’ose pas, de peur d’être accusé), l’histoire d’un procès intenté pour avoir complimenté la jupe d’une collègue, les « bases » graduelles très codifiées d’une relation, en somme un terrain d’entente entre l’ultra-puritanisme et le féminisme radical et intersectionnel des jeunes Américaines de gauche. Il ne vient pas souvent à l’esprit que cela est un fantasme évident, qui repose sur une contradiction totale, la convergence entre deux Amériques que presque tout oppose et qui entretient le mythe de ce « féminisme puritain ». L’idée est la suivante : aux États-Unis, le féminisme serait devenu, non pas un outil d’émancipation et d’autonomie des femmes, mais, par l’obsession de la victimisation, un néo-puritanisme, anti-sexe, anti-homme, qui ne tient compte ni des lois ni des cultures nationales, un « nouvel ordre moral » pour reprendre l’expression de Jacques Julliard. Slate avait consacré deux articles en 2011 au sujet de cette « fake news » d’avant l’heure. La définition du harcèlement aux États-Unis met le consentement au cœur et englobe certes davantage de cas que celle retenue en France. Les dédommagements issus des condamnations sont souvent bien plus lourds qu’en France, donc les ressources humaines encouragent souvent les femmes à parler au plus vite afin de limiter les conséquences du procès – cela est propre à la culture américaine de la poursuite en justice systématique. Il y a donc ainsi davantage de structures d’écoute et moins de condamnations.
Cela n’a contraint en aucune manière la possibilité d’une romance : « La drague au bureau n’a d’ailleurs pas été éradiquée (et ce n’est pas le but). Selon un sondage publié sur CNN en 2004, 47% des personnes interviewées avaient déjà couché avec un collègue3. » De même pour le mythe de l’ascenseur non-mixte : « Répétez cette histoire aux États-Unis, et personne ne comprendra de quoi vous parlez. Non, les hommes américains ne voient pas les passagères d’ascenseur comme des accusatrices en puissance. On pourrait d’ailleurs rétorquer que la grande majorité des ascenseurs sont dotés de caméras, ce qui devrait calmer toutes ces supposées mythomanes (difficile de mentir quand il y a une preuve vidéo). »4
Celles et ceux qui en France s’inquiètent de la disparition du Don Juan un peu vulgaire et très tactile utilisent l’argument de la « parole à l’américaine », cette parole qui ostraciserait sur simple déclaration, pour corroborer ces clichés et écarter de fait la dimension intellectuelle des combats féministes. Depuis plusieurs décennies, les penseuses américaines queer intègrent le concept de domination dans l’élaboration des modèles de genre. Les ouvrages de recherche qu’elles produisent mettent en exergue les schémas sociaux qui guident nos comportements et qui entretiennent, subtilement, une différence genrée que seule la parole féminine pourrait logiquement identifier.
Qu’est-ce qui détermine la domination masculine ?
Ces « structures », telles que définies depuis Claude Lévi-Strauss dans la philosophie sociale, sont autant de mythes, d’habitudes, de réflexes et de tournures du langage qui conditionnent plus ou moins fortement les rôles féminins. Cela peut être très concret, comme le débat sur l’écriture inclusive l’a montré avec son lot de controverses et de polémiques. Cela peut porter sur des gestes très précis, des manières de toucher, de faire l’amour, de s’asseoir dans les lieux publics, qui sont parfaitement intériorisés par la majorité et qui semblent désormais d’une banalité folle.

La pensée féministe réhabilite la parole des femmes en tant que femmes, non parce que toutes les femmes seraient victimes à part égale et du seul fait de leur sexe, mais parce qu’elles ont une part de vie en commun face aux comportements masculins.
Croiser les recherches féministes avec les révélations de #metoo nous permet de creuser davantage cette question des mots à mettre sur les souffrances. A priori, ce n’est pas motivées par une « haine des hommes » que philosophes et militantes ont cherché à théoriser des phénomènes de société à caractère machiste ou discriminant. Il s’agit de comprendre que le harcèlement n’est pas le fait d’un individu isolé, ou même pire, d’un geste in fine mal compris, mais bien d’ajouter à la définition du harcèlement une forme de généalogie, sans quoi les hommes eux-mêmes ne pourraient saisir ce qui est pointé du doigt. Rappelons donc que si les femmes sont les mieux placées pour remarquer ce qui constitue le propre du machisme, c’est parce qu’elles disposent d’une vie entière pour accumuler les micro-agressions et repérer les inégalités. En accumulant les prises de conscience, l’individu agresseur est replacé dans un contexte : ce qui forge la personnalité masculine, ce qui constitue l’éducation dès la naissance de chaque petit garçon – et petite fille.
Olivia Gazalé a publié l’année dernière Le mythe de la virilité, un essai qui cherche à définir la virilité comme moteur de la structure de domination. L’auteure part du principe que la virilité est une construction idéologique, une forme de supériorité liée à la masculinité qui s’acquiert par des attributs culturels. La virilité définit une perfection (selon l’étymologie), et donc présente à l’homme l’idéal-type auquel il doit se soumettre, sans que la femme n’ait d’équivalent, la privant donc d’une perfection semblable. Les hommes eux-mêmes ont à se plier à ces codes pour atteindre un statut de « vrai homme », à montrer ostensiblement leur volonté d’atteindre ce statut et donc de faire preuve de l’agressivité nécessaire à pareille domination. La virilité doit impressionner, doit contenir de la force et non de la fragilité, afficher la puissance que confirme majoritairement la société : conquêtes sexuelles (pour procréer et séduire), réussite matérielle (pour briller et faire vivre sa famille), vigueur physique (pour se battre et protéger), etc. Au travers des sociétés et des siècles, l’apprentissage de la virilité s’est diversifiée mais n’a pas franchement faibli. Elle prend des formes diverses selon les modes et les moeurs mais se retrouve autour de symboles communs : la carrure, la force physique, l’ambition, l’apathie, la compétition, la performance. Ces caractéristiques ne sont pas arbitraires et visent intrinsèquement à la perpétuation des rôles, car on assortit aux hommes seuls les critères de la réussite, donc les modèles passés d’individus exemplaires sont très majoritairement masculins et ne peuvent aider les filles des générations suivantes à s’identifier à un possible accomplissement de soi.
Comment réagir face à la parole qui dénonce ?
Ces constats académiques doivent se nourrir de la parole populaire. La question est la suivante : comment permettre aux femmes de s’exprimer publiquement sur la réalité quotidienne du virilisme ? et qu’est-ce qui pourrait les en empêcher ? Deux concepts américains vont nous intéresser : « manterrupting » et « male tears »5. Le premier désigne la tendance des hommes à interrompre plus souvent leurs collègues féminines dans des discussions. Cela se mesure facilement à n’importe quelle réunion ou débat télévisé et est difficilement contestable6. Le second désigne une tendance à vouloir désigner le rôle d’homme comme aussi difficile que le rôle de femme, et donc à faire taire les revendications féministes par peur qu’elles « empirent » le statut social masculin. Faire des male tears, c’est nuancer, délégitimer, relativiser un témoignage d’une femme qui vous reproche un comportement propre aux hommes. Il ne s’agit pas de dire le vrai du faux, mais simplement de rabaisser une parole : refuser d’écouter une femme qui se dit victime, lui expliquer que c’est un effet d’optique ou que ce n’est pas si grave, rappeler qu’il existe aussi des hommes victimes de viol (4% des cas7) ou tout simplement refuser de prendre le temps d’écouter les détails. Quel intérêt à rappeler que toutes les femmes ne sont pas de pauvres victimes et les hommes d’effrontés violeurs ? Personne n’oserait soutenir cela sérieusement et personne d’ailleurs n’en verrait l’intérêt. L’enjeu est plutôt de savoir se mettre à la place du faible et de le laisser s’exprimer, alors que cela est d’ordinaire trop complexe de comprendre ce que cela représente que de dévoiler ce qui est ignoré par la majorité.

Christiane Taubira, dans une interview publiée dans Libération8, espère qu’un jour les hommes puissent faire une « expérience de la minorité ». Ils comprendraient ainsi l’absence de modèle féminin, la domination des structures de pouvoir et donc l’importance d’écouter et d’être écouté. Les hommes ont un véritable rôle à jouer : « Je pense que c’est aux hommes eux-mêmes de définir leur place, mais je ne pense pas qu’il doive y avoir une position collective des hommes. Même avec toutes les lois possibles, certains hommes seront toujours des goujats et certaines femmes penseront toujours qu’il est acceptable d’importuner. » Elle rejoint donc Olivia Gazalé sur ce point : si l’on sait se taire avec justesse pour essayer au moins de comprendre ce dont il est question, sans fantasmer, sans se braquer ou s’offusquer, et en s’intéressant à la réalité de cette « minorité », alors il est possible de penser une nouvelle masculinité sans perdre quoi que ce soit et même en se débarrassant d’un système collectivement néfaste.
Or, pour dépasser ces « male tears » et permettre aux hommes de considérer la réalité du harcèlement, il faut, semble-t-il, deux éléments : un terrain d’entente langagier et une structure politico-sociale qui ne place pas toujours les hommes en domination. Sur le premier point, il s’agit d’une lutte à moyen terme : identifier ce qui peut être méprisant ou vulgaire pour une femme et accepter qu’elle utilise bien les bons termes pour caractériser ce qu’elle a subi. En revanche, sur le second point, cela se corse. La majorité des éditorialistes, des personnalités politiques et des commentateurs étant des hommes, il est difficile de dépasser le modèle interrogateur-accusé. Surtout, cette réalité viriliste se retrouve dans la vie ordinaire et ce sont précisément les témoignages d’anonymes qui permettent de faire remonter cela.
Prenons-en un : celui d’une personne qui a pris la parole sur le site Friction Magazine il y a quelques mois, et dont le témoignage est accessible ici.9 Riche de détails et de sincérité, il relate un parcours post-viol face à la police et la médecine, représentants de l’État, et notamment de la manière de parler à une victime.
« Il faudrait déjà déterminer si vous avez vraiment été violée. Puisque vous ne vous souvenez de rien, comment vous pouvez savoir que vous n’étiez pas consentante ? » demande le commissaire de police. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, qui permet de comprendre l’importance de l’expression et du récit des victimes. Les phrases qui blessent, les questions qui décrédibilisent et les sous-entendus permanents sont autant d’obstacles à l’application de la loi. Le texte juridique, pourtant si clair, est rendu inopérant par les blocages de la parole quotidienne : incapacité psychologique et médiatique de relater les faits et agressions verbales ordinaires en face.
La mise en spectacle de la parole victimaire
La philosophe américaine Iris Marion Young a théorisé cela dans son essai Inclusion and Democracy. Elle explique notamment qu’une véritable démocratie ne se contente pas de prendre en compte les intérêts des minorités, elle doit aussi garantir à ceux qui s’estiment dominés un espace où s’exprimer. Si les minorités sont sous-représentées à tous les niveaux, ou si les individus victimes ne peuvent se rendre compte que leur oppression est due à une caractéristique de genre, économique ou politique, alors leur témoignage ne sera jamais vraiment écouté. Tant que le discours des victimes n’est pas retranscrit dans sa sincérité et écouté avec attention, la démocratie restera dans le spectacle et non dans l’action.
Le spectacle politique est devenu ordinaire. Comme suggéré au début de l’article, l’hyper-communication repose sur le buzz et donc sur les conséquences de la parole et non plus les causes. L’exemple type est ce clash entre Christine Angot et Yann Moix d’une part, et Sandrine Rousseau de l’autre, sur le plateau de On n’est pas couché10. Tout y est : la scène, le montage, le public et les réseaux sociaux qui, avant et après diffusion, affûtent leurs réactions. Sandrine Rousseau, ancienne élue EELV qui a été parmi les premières à dénoncer les agressions sexuelles dans le milieu politique à l’occasion de l’affaire Baupin et désormais responsable associative dans la lutte contre le harcèlement sexuel, fond en larmes face à l’écrivaine-chroniqueuse. En cause, une formule de Sandrine Rousseau : « former pour accueillir la parole ». Alors que l’ancienne femme politique souhaite développer des structures d’écoute des témoignages dans les entreprises et les partis, Christine Angot défend une individualisation des cas : chaque viol serait spécifique, chaque femme violée indépendante des autres. En d’autres termes, ce serait là l’abandon de toute lutte politique et Sandrine Rousseau s’y refuse. Au-delà des enjeux, c’est la forme de la séquence qui interpelle. Une femme en larmes pendant de longues minutes, pendant que l’émission suit son cours, peine à s’exprimer. Yann Moix enchaîne et blesse l’invitée : au final, rien n’aura été dit, le témoignage de Sandrine Rousseau n’aura jamais pu être écouté. La démonstration est ainsi faite : aujourd’hui, les victimes ont honte et notre société n’est pas encore prête pour accueillir leur parole.
- https://www.youtube.com/watch?v=sphZS8JVwNc
- http://www.lejdd.fr/Politique/Harcelement-sexuel-L-impunite-c-est-fini-785595
- http://www.slate.fr/story/38941/france-etats-unis-seuils-tolerance-sexisme
- http://www.slate.fr/story/46401/feminisme-etats-unis-mythe-ascenseur
- https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2015/08/22/des-male-tears/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Manterrupting
- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/18/les-violences-sexuelles-touchent-plusieurs-millions-de-femmes-en-france_5202391_4355770.html
- http://www.liberation.fr/france/2018/01/28/christiane-taubira-il-est-temps-que-les-hommes-fassent-l-experience-de-la-minorite_1625775
- https://friction-magazine.fr/culture-viol-feat-lesbophobie-ottoline-deteste-police/
- https://www.youtube.com/watch?v=ne6DS_h9nwI