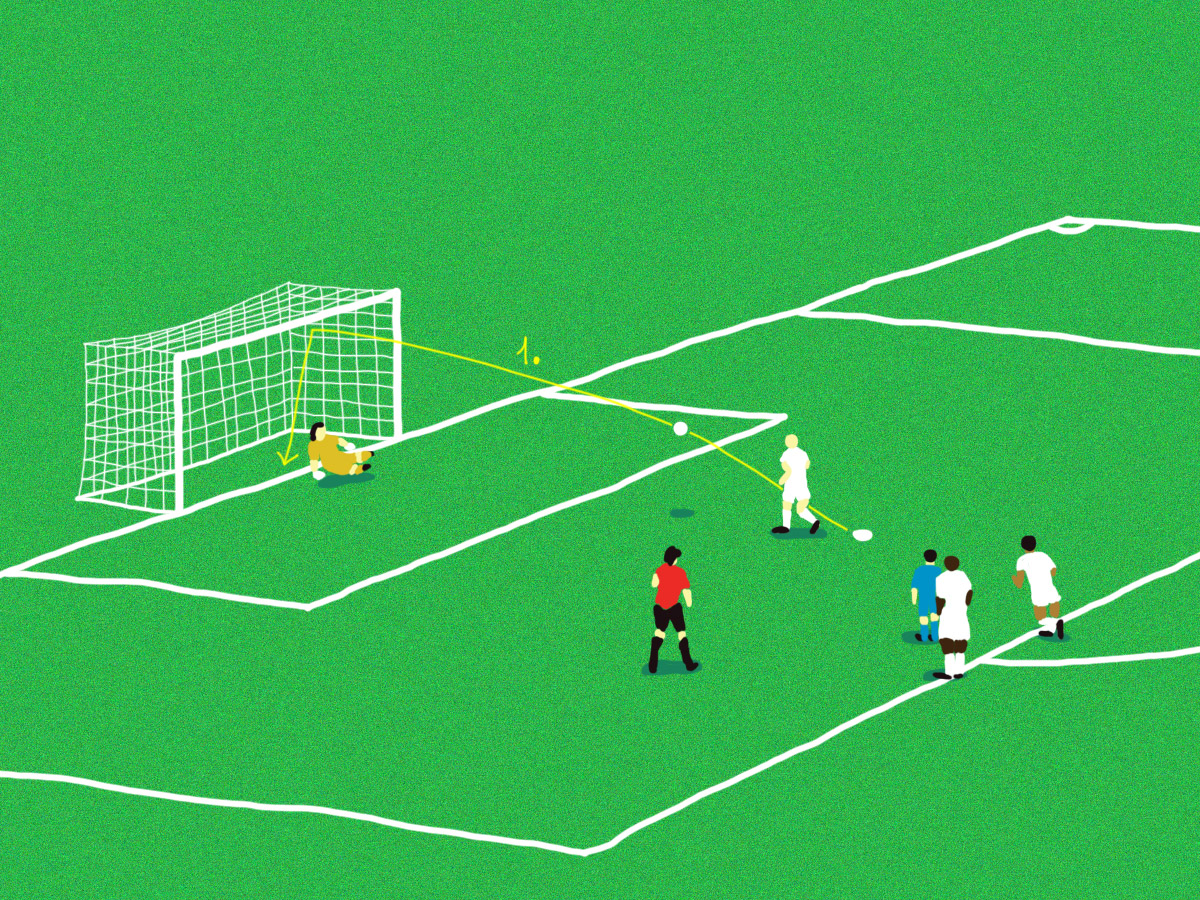Apolline Lesueur Mimrame (rédactrice), Paul Poirier (artiste)
Au Québec, les étudiants étrangers sont dans l’obligation de souscrire à une assurance médicale privée, imposée par leur université. Pour 1 000 dollars par an, ils n’ont aucun contrôle sur la nature de leur contrat, ce qui conduit parfois à des situations dramatiques.
Une enquête conduite par Apolline Lesueur Mimrame et des photos de Paul Poirier, à Montréal.
Àla rencontre de Puya Ghasvareh à Montréal, il raconte son histoire. En juin 2016, cet étudiant iranien, remarque qu’il a une bosse à la gorge. Inquiet, il se rend à la clinique de l’Université Concordia, où il étudie en économie. Le médecin le rassure : son cas n’est pas sérieux. Il prescrit quand même une biopsie, par prudence. « C’est un problème général au Canada. J’ai dû attendre 8 mois parce que mon cas n’était pas sérieux, je n’étais pas une priorité », confie le jeune homme.
Quelques mois plus tard, il s’aperçoit qu’une seconde bosse s’est formée dans sa gorge. En janvier 2017, il décide donc de se rendre dans trois différentes cliniques privées. Ce n’est qu’en février qu’on lui annonce la nouvelle : il est atteint d’un cancer du système lymphatique. Non seulement ces huit mois d’attente auront été source d’angoisse, mais son cancer est passé entre temps du stade 2 au stade 4. En conséquence, les traitements sont bien plus lourds et pénibles que ce qu’ils auraient dû être.
Commence alors une longue bataille contre la maladie… deux batailles en fait. Car son assureur, La Croix bleue, refuse de couvrir ses traitements. Puya a donc dû mener une longue négociation avec son assureur pour obtenir le remboursement de son traitement, qu’il ne pouvait, d’aucune manière, assumer lui-même.
Pour sa première séance de chimiothérapie, le jeune malade se rend à l’hôpital du Sacré-Cœur, au nord de Montréal. Au dernier moment, l’hôpital annule son traitement. La raison ? L’assurance refuse de payer ses frais. « Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas couvrir les injections parce que ce traitement était trop nouveau et que même les Canadiens ne se soignaient pas avec ces médicaments. C’était faux puisque mon médecin m’a dit que dans cet hôpital, tous les patients étaient traités avec ça. » Chaque injection coûte 8 000 $. Cela dépasse ses moyens. Ce n’est qu’avec beaucoup de zèle que le jeune homme, aidé par sa conseillère universitaire, obtiendra en fin de compte l’accord de la Croix Bleue.

Le cas de Puya n’est pas isolé. Awa Cheikh Diop, une jeune sénégalaise étudiante à l’Université de Québec à Chicoutimi (UQAC), a fait face au même problème. En arrivant au Québec, en 2014, la jeune femme est enceinte de deux mois. Cinq mois plus tard, elle accouche prématurément. S’en suivent deux mois d’hospitalisation pour le nouveau-né et pour la jeune maman.
L’assureur Desjardins refuse de couvrir les frais d’hospitalisation des deux patients parce que la jeune femme était déjà enceinte avant d’arriver sur le territoire. Dans une situation où les frais supplémentaires sont liés à un « état de santé préexistant », la caisse Desjardins (à laquelle l’UQAC a eu recours), s’accorde une exception de remboursement au-dessus de 10 000 $.
Pour M. Bouchard, membre de la communication de la caisse Desjardins, c’est l’université qui est à blâmer dans ce cas. « L’assureur est là pour administrer les positions que le preneur va lui demander de gérer, mais ce n’est pas l’assureur qui va décider qu’il y ait une clause comme celle des états de santé préexistants ou d’appliquer un maximum de 10 000. »
Pour Puya Ghasvareh comme pour Awa Cheikh Diop, leur régime d’assurance leur a été imposé. En effet, au Québec, il existe une loi qui force les étudiants étrangers à souscrire à une assurance santé imposée par leur université. L’Université de Québec à Montréal (UQAM) et l’Université de Montréal (UdeM) collaborent avec Desjardins tandis que Concordia ou McGill ont choisi La Croix Bleue. Les étudiants ne participent pas à l’élaboration de leur contrat.
Termes très flous

Ni la Croix Bleue, ni Desjardins n’ont accepté de donner plus de détails sur l’étendue de leur couverture et sur les termes « condition préexistante » ou « états de santé préexistants » présents dans leur contrat avec les universités. Ils insistent sur le fait que les universités avec lesquelles ils ont négocié sont les seules à pouvoir définir les termes de l’assurance offerte.
La directrice du bureau des étudiants étrangers, Angela Ghabdan, estime que ce terme est parfaitement expliqué dans le contrat. « Le contrat d’assurance ne couvre rien qui a déjà été traité avant de ratifier le contrat », assure-t-elle. Malgré certains exemples qu’ils ont négociés avec la Croix Bleue, tels que le diabète, l’asthme ou l’épilepsie, les maladies déjà traitées auparavant ne seront pas remboursées. Demeurent certains questionnements au sujet de cette clause du contrat, qu’en serait-il d’un étudiant qui n’a pas été diagnostiqué, mais qui serait déjà malade en arrivant..
Ce n’est pas le seul problème que pose le contrat. D’autres clauses sont très floues et, malgré l’avertissement de Puya, rien n’a été changé dans le contrat. On y mentionne par exemple que les frais hospitaliers sont pris en charge pendant 30 jours en cas de maladie ou d’accident. En revanche, le contrat indique que la compagnie d’assurance payera jusqu’à 25 00 0$ par an et par personne pour les médicaments prescrits (sauf dans le cas où il y a une condition préexistante, auquel cas, elle ne remboursera que jusqu’à 7 500 $). Pour Puya, La Croix bleue considérait que la chimiothérapie rentrait dans la catégorie des « médicaments prescrits » (avec remboursement limité) et non des frais hospitaliers même si son traitement lui était administré directement à l’hôpital.
« La chimiothérapie et quelques autres types de traitements qui sont couverts par la RAMQ pour ceux qui y ont le droit sont généralement couverts comme les frais hospitaliers. Dans ce cas, la limite qui existe pour la prescription de médicaments n’est pas prise en compte, et le malade peut dépasser la limite de 22 500 », ajoute Mme Ghabdan, en insistant sur le fait que cette couverture médicale assure la sécurité des étudiants. Pour elle, ces problèmes sont plutôt liés à une mauvaise communication entre les courtiers en assurance et les professionnels de la santé : « Ce contrat d’assurance est excellent. Les problèmes qui se posent se trouvent à un autre niveau, il y a une mauvaise transmission des informations, entre l’assurance et les hôpitaux, les cliniques et, les docteurs. »
D’autre part, dans son combat contre la maladie, Puya a dû, avant même d’être certain qu’il avait un cancer, passer par trois différents tests, très coûteux. Charges d’hôpital liées à une maladie ou frais médicamenteux ? Pour l’assurance, il s’agit d’une prescription médicale. Compte tenu du prix très élevé de ces tests, Puya avait, avant même de commencer ses traitements, franchi le seuil des 25 000 $.
Après avoir contacté son assurance à maintes reprises, et avec l’aide de sa conseillère universitaire du bureau des étudiants étrangers, Anna Nigoghosian, Puya a finalement réussi à se faire rembourser la plupart de ses frais de santé. Ce n’est pas le cas de tous. Cela peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Amirbahram Kaganj, également originaire d’Iran, n’y est pas parvenu. « Il a été diagnostiqué d’un cancer arrivé au stade 4, raconte son meilleur ami à Montréal. La Croix bleue ne couvrait pas tous les frais d’hospitalisation. Quand la situation s’est stabilisée, le médecin a décidé de l’envoyer en maison de repos, moins chère et couverte par l’assurance, contrairement à l’hôpital. Sauf qu’il aurait dû, à ce moment-là, obtenir un suivi de professionnels de la santé ! Deux jours par semaine, il devait faire trois allers-retours à l’hôpital pour prendre son traitement ou faire des prises de sang, alors qu’il souffrait énormément. » Comme Puya, ce jeune homme avait été mal diagnostiqué par la clinique de Concordia qui lui avait prescrit des antalgiques, après qu’il se soit plaint de fortes douleurs dans le dos.
De la même façon que pour Puya, la Croix bleue avait refusé de payer pour les frais des médicaments les plus adéquats, qui auraient potentiellement pu le sauver. Lui n’a toutefois pas eu la chance d’obtenir ce que Puya a obtenu. Il y a laissé sa vie, avec une famille derrière lui. Il était le père de deux enfants.

Responsabilité des médecins
Dans un code de déontologie, l’association médicale canadienne (AMC) définit les 54 règles déontologiques que les médecins se doivent de respecter à l’endroit de leurs patients. Ces professionnels de la santé se doivent notamment de « fournir toute l’aide appropriée possible à quiconque a un besoin urgent de soins médicaux ». Ils ont aussi le devoir de « reconnaître que les médecins doivent favoriser l’accès équitable aux ressources consacrées aux soins de santé ». Dans la situation de Puya, ces deux responsabilités éthiques étaient bafouées.
Il raconte, par exemple, que lors de sa 4e séance de chimiothérapie, l’infirmière a arrêté l’injection en plein milieu. « Ils m’ont dit que la séance n’avait pas été réglée par l’assurance et que je devais payer tout de suite. Mais vous savez, j’étais seul, et quand vous recevez ce type de traitement vous êtes très étourdi et un petit peu sonné. C’est une faute éthique et professionnelle », raconte-t-il. Cette expérience a été pour Puya, un outrage psychologique, qui a, de surcroît, retardé l’avancement de son traitement.
Le député Québec Solidaire, Amir Khadir, est également médecin. Cet enjeu le préoccupe et Puya est déjà allé le rencontrer à la fin d’une conférence de presse. Conscient que Puya n’est pas un cas isolé, le député réclame un changement de la situation. Selon lui, ces pratiques dérogent à la déontologie à laquelle les médecins sont soumis : « C’est inadmissible ! Pour des cas comme cela, des maladies tout à fait imprévisibles comme le cancer, quand c’est une question de vie ou de mort, c’est inadmissible. » Malheureusement, même si le député soutient que ce genre de maladies doit être traité très rapidement, les médecins de Puya ne lui ont pas permis d’être pris en charge en urgence.
Le problème vient en bonne partie de ce que la médecine considère comme une « urgence ». Si les médecins se retrouvent face à une urgence, ils s’occuperont du patient, avec ou sans assurance. « Si par exemple vous avez un accident et que vous allez mourir dans l’heure, dans ce cas ils vous feront passer une échographie en urgence, mais le cancer n’est pas considéré comme une urgence, » déplore Puya.
Dans son cas, tout le processus de diagnostic a été très long. Il a notamment dû passer une échographie et une biopsie. Et même si cette maladie ne tue pas quelqu’un en une heure, elle a eu le temps pendant ces mois de latence, de grandir et de s’aggraver. Avec ironie, Puya parvient même à en plaisanter : « J’ai une blague avec mes amis, on appelle ça la patience canadienne. Mais il y a une limite, il me semble, à être patient ! »
Un système oligopolistique
Pour Amir Khadir, il existe une solution très simple, il faudrait que les étudiants internationaux, au même titre que les résidents et les citoyens québécois, relèvent de la régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). « Quitte à demander aux étudiants de prévoir, à l’intérieur de leurs frais de scolarité comme étudiants internationaux, un montant pour les assurer. Les assurances publiques seraient quand même beaucoup plus souples que les assurances privées et sans doute moins chères, avec une couverture plus grande », assure-t-il.
Il considère que cette solution est tout à fait réalisable. En effet, la RAMQ parvient déjà à couvrir 8 millions de Québécois, ces quelques centaines de milliers d’étudiants étrangers ne représentent pas une charge additionnelle majeure. D’ailleurs, tous les étudiants étrangers dont le pays a signé un accord bilatéral avec le gouvernement québécois sont exemptés des frais d’assurance privée. Ces dix pays jouissent déjà, au même titre que les citoyens québécois et des résidents, de l’assurance maladie de la RAMQ. Voilà pourquoi il estime que cela pourrait marcher pour les 218 000 étudiants étrangers présents sur le territoire, incluant les étudiants bénéficiant de la RAMQ, grâce aux accords précédemment cités. « On le sait, le régime d’assurance publique c’est moins de 2 % de frais d’administration alors que les régimes d’assurances privés c’est plus de 10 % et en moyenne. », précise-t-il. Ce serait l’une des raisons des différences de prix entre les deux types d’assurance.
Puya, lui, propose une solution plus proche du système actuel. Pour cet étudiant en économie, la mise en concurrence des compagnies privées d’assurance permettrait aux étudiants d’avoir un meilleur service. Il faudrait donc donner aux étudiants l’opportunité de choisir la compagnie d’assurance qu’ils désirent. « Je sais que le problème vient principalement du système oligopolistique, » estime-t-il. Les étudiants se retrouvent dans une situation où ils n’ont aucun moyen de pression sur leurs assureurs et ne peuvent pas les menacer de changer de compagnie.

Des laboratoires pharmaceutiques peu scrupuleux
Dans sa longue bataille contre la maladie, Puya a rencontré d’autres malades confrontés à des situations comme la sienne. L’un d’eux s’est renseigné sur les prix de ces médicaments ailleurs qu’au Canada, et les a comparés. La différence est colossale.
Ce jeune homme, qui préfère garder l’anonymat, également né en Iran, est atteint d’une sclérose en plaque. Cette maladie auto-immune du système nerveux ne se guérit pas. Par conséquent, les personnes qui la développent sont contraintes de prendre un traitement très onéreux, pendant toute leur vie. Cette maladie répertoriée comme étant l’une des maladies les plus chères à traiter au Québec, est décelée en moyenne entre 30 et 35 ans. Les malades doivent donc prendre ce traitement au moins 15 ans, jusqu’à ce que la maladie arrive à un stade plus grave. Ils ne changeront de traitement qu’à ce moment-là.
Or, l’homme s’est rendu compte de l’exorbitante différence de prix qui existe entre les États-Unis, le Canada et l’Iran : pour les mêmes médicaments, distribués par les mêmes laboratoires pharmaceutiques, le traitement contre la sclérose en plaques coûte 2 600 $ en Iran, alors qu’il monte jusqu’à 22 700 $ au Canada, voire 89 000 $ aux États-Unis.
En adaptant leur prix en fonction du pays dans lequel ils distribuent ces traitements, ces laboratoires ne se distinguent guère de quelque autre industrie, dont l’objectif principal serait de faire du profit. Une question éthique se pose alors : la vie humaine est-elle monnayable ? Autrement dit, ils mettent en pratique l’une des règles de base du capitalisme : ils fixent leur prix en fonction de l’offre et de la demande.
Pour M. Khadir, c’est aussi l’un des problèmes majeurs de la situation de la médecine dans bien des pays et le Québec ne fait pas exception. « Jusqu’à très récemment, le Québec était l’un des 3 endroits où les médicaments étaient les plus chers au monde » s’insurge-t-il. Il explique que le gouvernement utilise de faux prétextes pour justifier ces prix : « Le gouvernement prétend qu’il investissait dans la recherche et le développement, mais on a vite su que c’était de la bouillie pour les chats. » Ainsi, bien que les assurances aient une grande part de responsabilité dans les problèmes auxquels sont confrontés certains de ces jeunes malades étrangers, c’est peut-être aussi à la source même de la production qu’il y aurait des choses à changer. D’après le député et médecin, le coût de production d’une pilule coûte en moyenne 10 cents l’unité.
Si Puya ne décide pas de rentrer, malgré cette lutte acharnée contre son assurance, c’est parce que sa vie est ici maintenant. « Les médecins que j’ai contactés en Iran m’ont dit qu’ils avaient tout pour me traiter correctement là-bas. Mais je n’ai rien à y faire ni emploi ni étude. Et puis, j’aurais dû retourner vivre chez mes parents, ils pleurent tout le temps, ils sont très choqués. Ma femme est ici, elle a son travail. C’était vraiment mieux pour mon moral que je reste ici », raconte-t-il. Pour se faire soigner en Iran, il aurait dû se séparer de son épouse pour au moins 6 mois. Mais il avait besoin de son soutien pour ce long traitement qu’est la chimiothérapie, quitte à se battre perpétuellement contre son assurance.
- Interview téléphonique avec Amir Khadir
- Interview de visu avec Puya Ghasvareh
- Interview de visu avec Esmaeel, le meilleur ami du défunt
- Interview par courriel avec la directrice du bureau des étudiantes étrangères Angela Ghabdan
- Interview par courriel avec Ali, ami du Puya, atteint de la sclérose en plaques
- Échanges téléphoniques avec conseiller de la Croix bleue
- Interview téléphonique avec M. Bouchard, représentant de la communication de la caisse Desjardins
- Statistiques Canada : http://www.international.gc.ca/education/report-rapport/economic-impact-economique/sec_4.aspx?lang=fra
- Article de Radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/759458/etudiants-etrangers-problemes-protection-assurance-medicale
- Site de l’université Concordia , contrat signé avec le Croix Bleue : https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/T17-ISO-Blue-Cross-Handout-How-to-register.pdf