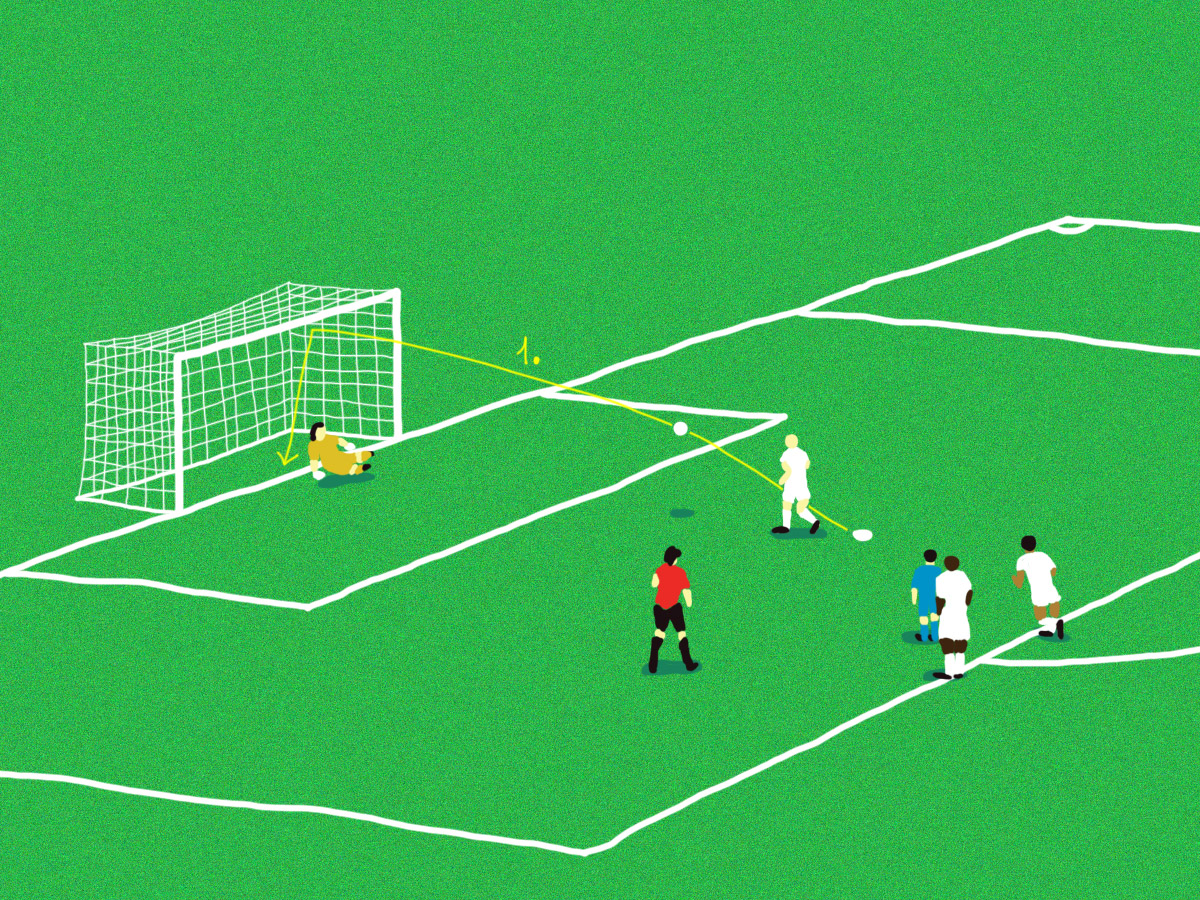Charline Barber (artiste), Hugo Do Peso (rédacteur)
Parler de marketing dans le milieu de la culture n’est pas toujours de bon ton. Dans un pays comme la France, réputé mondialement pour ses institutions muséales, théâtrales et musicales, l’application des règles mercantiles en ces lieux de sublimation esthétique serait sans doute sacrilège. Preuve en est, leur modèle économique repose la plupart du temps – dans le secteur public du moins, majoritaire parmi les grands noms – sur trois grands critères : la non-rentabilité (et non la recherche du profit), l’exigence de l’excellence (et non la chasse aux coûts superflus) et la diversification des publics par âge et classe sociale (et non la recherche d’une clientèle spécifique). Il existe aussi, plus ou moins explicitement selon les directives de l’État, un devoir de défense de certaines valeurs – artisanat, transmission, authenticité. Aussi les institutions culturelles ne peuvent-elles pas être de simples entreprises : elles ont toujours eu une place particulière en France, à travers les monarchies et les républiques. Louis XIV est ainsi communément admis comme un pionnier de la reconnaissance étatique des structures artistiques, à la fois en tant que mécène et protecteur, mais aussi en fin stratège. Depuis le XVIIe siècle, nos institutions culturelles sont de puissants outils de diplomatie et de rayonnement international, du soft power avant l’heure, et nous pourrions même dire des incarnations de la nation française. Il ne suffit pas simplement de constater et de compter tous les bienfaits que ces mastodontes de la culture ont apporté à notre pays et ses citoyens, car l’heure est aux bouleversements structurels et la consommation esthétique n’est pas en reste. Comme pour tout modèle séculaire, les mutations économiques, sociales et technologiques ont bousculé notre rapport au spectacle et au musée. Les publics n’ont plus les mêmes attentes, les mêmes références, les mêmes codes, alors même que l’excellence artistique a bien souvent une prétention à l’intemporel et donc à l’immuable. Les impératifs de survie budgétaire et de pérennisation par-delà les chambardements sociétaux qui, génération après génération, renouvellent nos exigences culturelles, sonnent comme un dur rappel à la réalité : il est fini le temps de l’exception artistique, celle qui exonérait nos champions de la culture des lois du marché.
Quelles sont les défis à relever ?
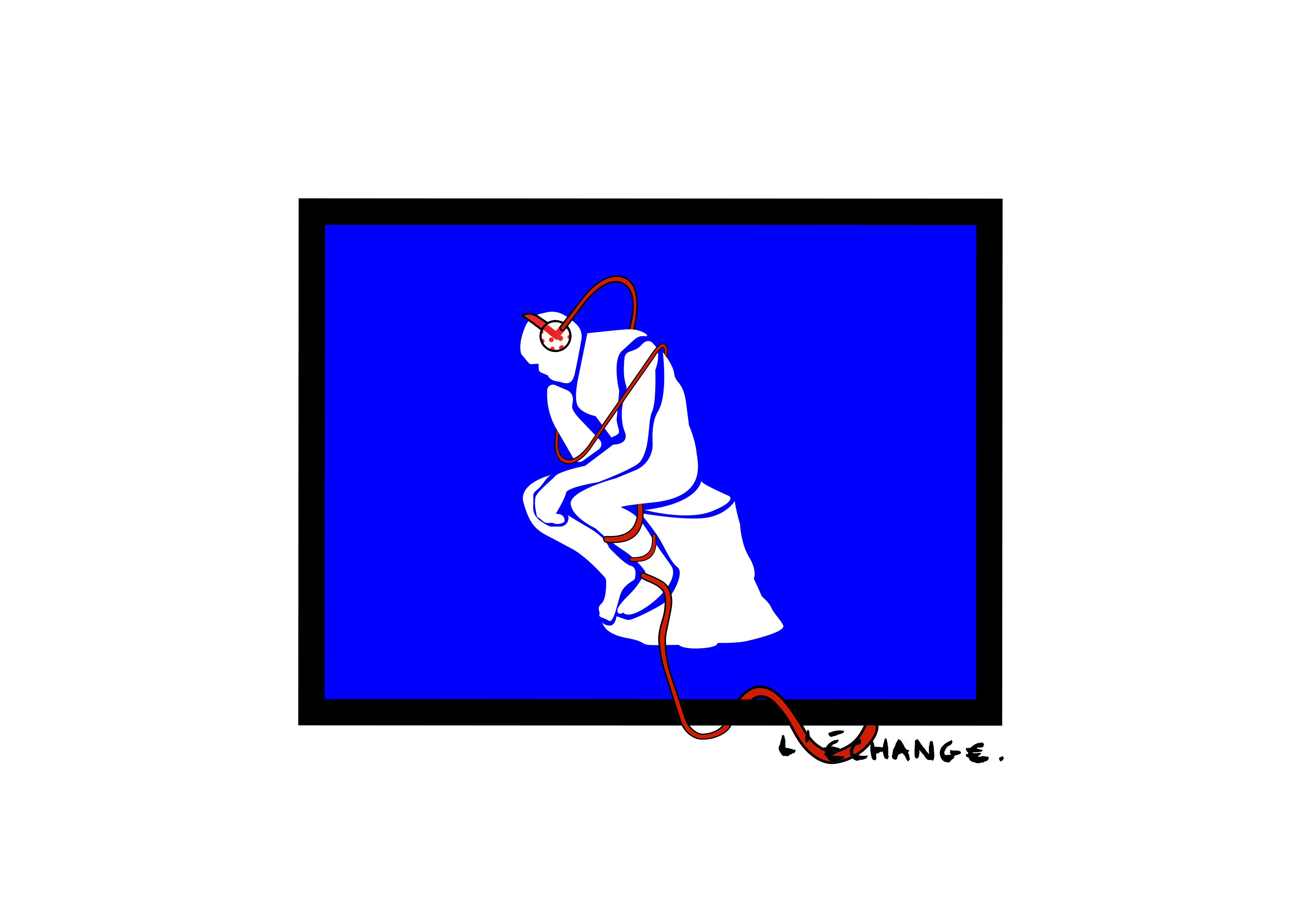
D’un côté, ce sont bien les lieux privés – fondations, salles de concert, mais aussi parcs d’attraction, salles de congrès et établissements mixtes publics-privés – qui imposent, par la concurrence et la maîtrise de la communication, de nouveaux défis aux grands noms de la culture. D’autre part, l’État, rognant progressivement sur les montants parfois colossaux de subventions alloués, pousse à la viabilité budgétaire des lieux qui ne l’ont jamais connue. Pris en étau entre la fougue du mercantile et le désengagement des pouvoirs publics, certains grands noms, comme l’Opéra de Paris, se retrouve alors dans une situation critique : depuis quatre ans, les subventions représentent moins de la moitié de leurs recettes. Qui dit moment critique dit moment de choix : la quête aux nouveaux financements s’est alors intensifiée. D’abord, la billetterie a été affinée en outil stratégique, selon une méthode proche du yield management, c’est-à-dire grappiller du revenu en adaptant les prix aux catégories de client. Ensuite, une politique de mécénat (dons privés), peu développée en France, s’est mise en place pour récolter une quinzaine de millions d’euros. Enfin, la diversification des activités a permis à l’Opéra de se garantir des ressources annexes, issus du bar, de boutiques, d’activités de tourisme et de loisir ou encore de location d’espace. Cela n’empêche pas un besoin de réduire également certaines dépenses, conférant ainsi une légitimité nouvelle aux managers de ces industries qui rendent encore possibles des créations faramineuses, dont l’excellence est aussi mise en concurrence (la meilleure chanteuse lyrique face à l’Opéra de New York, les décors les plus époustouflants face à la Scala de Milan, etc.)
Pour des lieux comme l’Opéra, la tâche n’est pas seulement économique mais aussi sociétale. L’art de l’opéra est souvent perçu comme vieillissant, conservateur et élitiste. À l’heure de la télévision, de la performance, de l’art contemporain et du divertissement de masse, les longues œuvres chantées et costumées, ancrées dans des époques révolues ou dans des langues étrangères, n’ont plus autant de prestige. Aussi l’institution se trouve-t-elle en fer de lance du renouvellement de la discipline : mises en scène audacieuses et modernisées, ballets contemporains, riches des cultures urbaines actuelles, renouvellement des répertoires et des artistes. L’opéra du XXIe est l’opéra qui sait parler à son public, donc ce que le lieu est en mesure de produire selon les artistes et selon les spectateurs. La dépendance aux publics, divers et inconstants, est cruciale, car même si l’on a coutume de dire que l’art subventionné se doit d’aller parfois à contre-courant du goût populaire, du simple divertissement, pour viser la stimulation intellectuelle, on ne peut jamais ignorer ce qui motive la démarche de payer – parfois cher, comme à l’Opéra, entre 100 et 200 euros la place en général – chez le consommateur-esthète.
Et quand bien même, la gratuité ne suffirait pas toujours car il s’agit de savoir communiquer sur les créations proposées. Pour clamer que l’Opéra est « branché » ou « modernisé », il faut mettre en place des contenus et des supports adaptés à la stratégie de ciblage des publics. Or, l’Opéra de Paris ne peut se vendre comme une marque industrielle quelconque : le caractère fantasmé doit être préservé pour maintenir la fonction même d’un art d’élite – vendre du rêve, ce n’est pas vendre à tout prix. L’affichage public est discret, fuit le tape-à-l’œil ou le rabattage commercial pour préférer l’information neutre, esthétique et sobre. La communication média est soignée et se veut haut de gamme, à l’instar des grands noms du luxe. Les outils digitaux, peu naturels dans la sphère artistique, sont intégrés et optimisés, par exemple via une troisième scène en ligne pour visionner des spectacles.
Les leviers de la communication culturelle
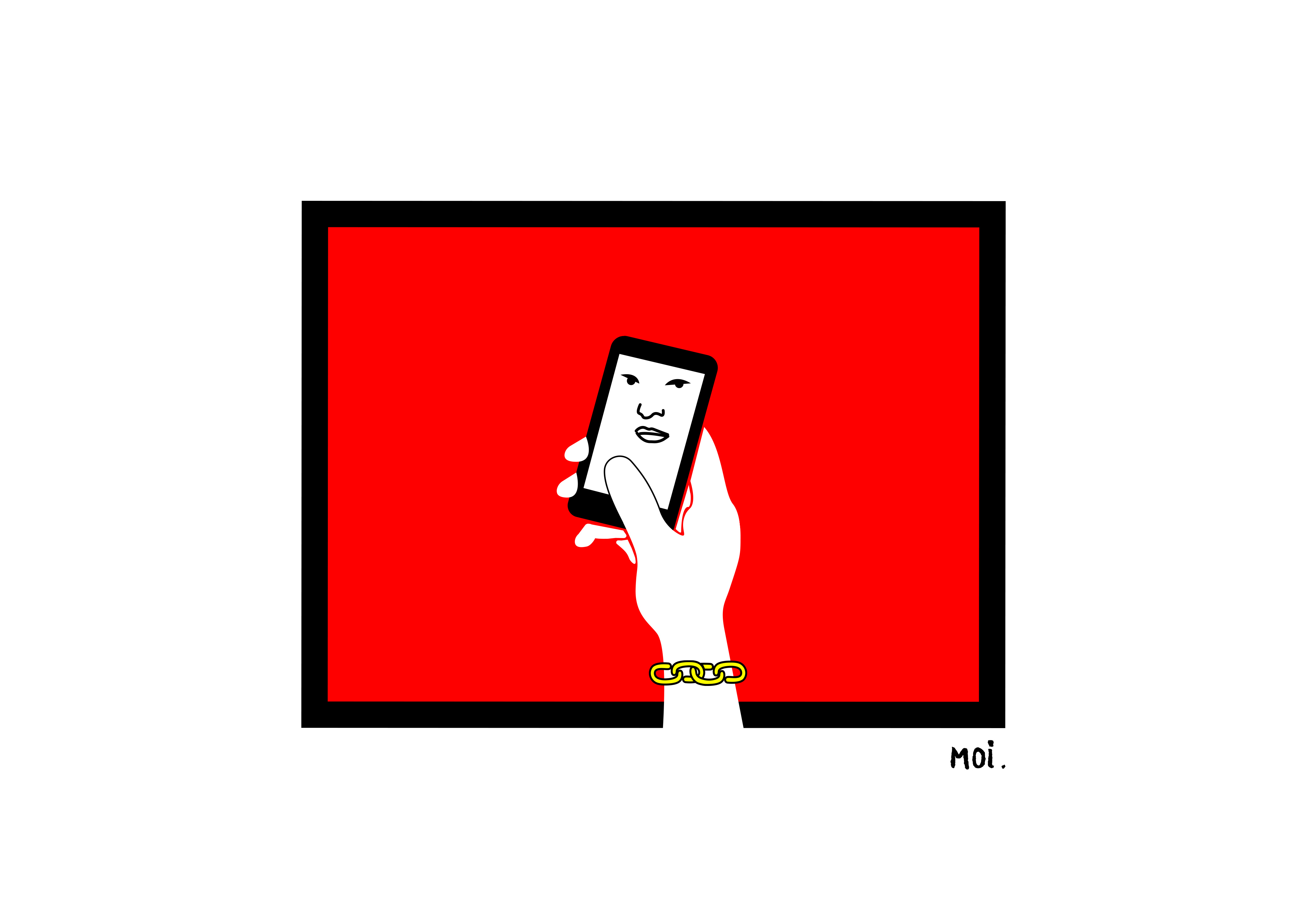
Ce point-là est crucial : comment les lieux peuvent-ils se rendre audibles auprès des nouvelles générations, alors qu’ils se retrouvent perdus au milieu de la sphère du loisir, tombés du piédestal de l’élite culturelle et en proie au risque de ringardise ? Au-delà du changement d’offres, afin de mettre au goût du jour leurs propositions artistiques, c’est un véritable travail de persuasion auquel doivent s’atteler ces lieux. Ces dix ou vingt dernières années, nous avons pu constater un réel effort de la marque des grandes institutions pour peaufiner leur image. Si dès le début du XXe siècle, des graphistes en vogue ont travaillé avec de grands musées pour leurs affiches, la conception d’identités visuelles globales peine pourtant à émerger, et notamment en France, à cause de la spécificité déjà mentionnée de cette sacralité historique des lieux culturels. Ce n’est pas le cas dans le monde anglo-saxon, où la communication est assumée depuis toujours. Le Guggenheim et le MoMA new-yorkais sont les parangons des « marques-art », pour lesquels le nom, le design et la charte graphique du lieu comptent presque autant que les œuvres exposés. À l’inverse, en France, l’identité visuelle des musées a souvent été confuse, non-stratégique et mise à l’écart, privilégiant l’histoire des murs et la primauté absolue des œuvres sur le reste.
Cela n’empêche pas les lieux culturels français de se mettre lentement à la communication visuelle. Les logos des lieux sont modernisés, déclinés selon le format et épurés pour davantage de cohérence entre les supports. Bien souvent, on retrouve l’association d’une image au nom : pour le Centre Pompidou, la Monnaie de Paris, le musée Carnavalet ou plus récemment la Seine Musicale, c’est le lieu même qui est figuré, de manière stylisée et en bichromie. C’est une tendance courante en France et qui témoigne vivement de l’attachement que nous avons aux murs, et donc au concret, comme un refus de pousser la marque culturelle à l’abstraction complète. Cela vaut aussi pour le quai Branly, qui fait figurer la plupart du temps une poterie iconique du musée à côté de son nom logotypé, tandis que le musée de l’Homme ajoute une illustration très figurative. Quelques lieux pourtant reprennent la tendance forte du graphisme anglo-saxon qui se base uniquement sur le nom de lieu, les lettres qui le composent et toutes les déclinaisons typographiques possibles. Le musée d’Orsay a ainsi fait évoluer son logo pour ne garder que les éléments « M’O », tronqués de moitié, en noir et blanc, et d’une police extrêmement classique, conférant à la marque « Orsay » une solennité, mais aussi une sorte d’évidence : tout le monde sait ce que c’est, où c’est, et ce que ça propose, on se contente donc du strict minimum, on peut se le permettre. De nombreux musées modernes conservent le nom complet mais jouent avec le texte, le déstructurent, le décorent ou le rendent même évanescent. Le Palais de Tokyo, le musée d’Art Moderne de la ville de Paris ou le musée Picasso, à fort potentiel de séduction des publics jeunes, misent sur des logos simples et textuels, à la fois explicites et flous, esthétisés par un seul travail sur l’écriture du nom.
Le logo seul ne suffit pas, il convient alors de développer une identité complète qui marque l’esprit du public. Chaque citadine et citadin a sans doute en tête les affiches des musées et salles de spectacle dans le métro ou sur des panneaux d’affichage. La Comédie-Française par exemple, depuis quelques années, a opéré un changement graphique audacieux, basé sur des contrastes vifs, des typographies déconstruites, brutales, sur les initiales des œuvres érigées en véritables illustrations, la plupart du temps sans aucun visuel. Ces affiches originales sont à la fois un retour aux origines du design graphique (affichage public textuel, accrocheur et centré sur la typographie) et un signal fort des tendances actuelles sur l’épuration de la forme du message afin d’accrocher l’œil des jeunes comme de toutes les personnes pressées qui ne s’arrêteraient pas devant une affiche quelconque. De même, sur le Web, les publicités en ligne, souvent en bandeau ou en petite image insérée sur la page, comme les éléments de la charte graphique sur les pages officielles des lieux culturels, sont vus inconsciemment et lesdits lieux doivent faire preuve d’efficacité pour être identifiés instinctivement. Le quai Branly a ainsi décliné son logo en multiples formats, et surtout son signe caractéristique, une astérisque « faite à la main » qui donne une continuité et un liant à la communication du musée.
La marque et l’imaginaire du lieu culturel
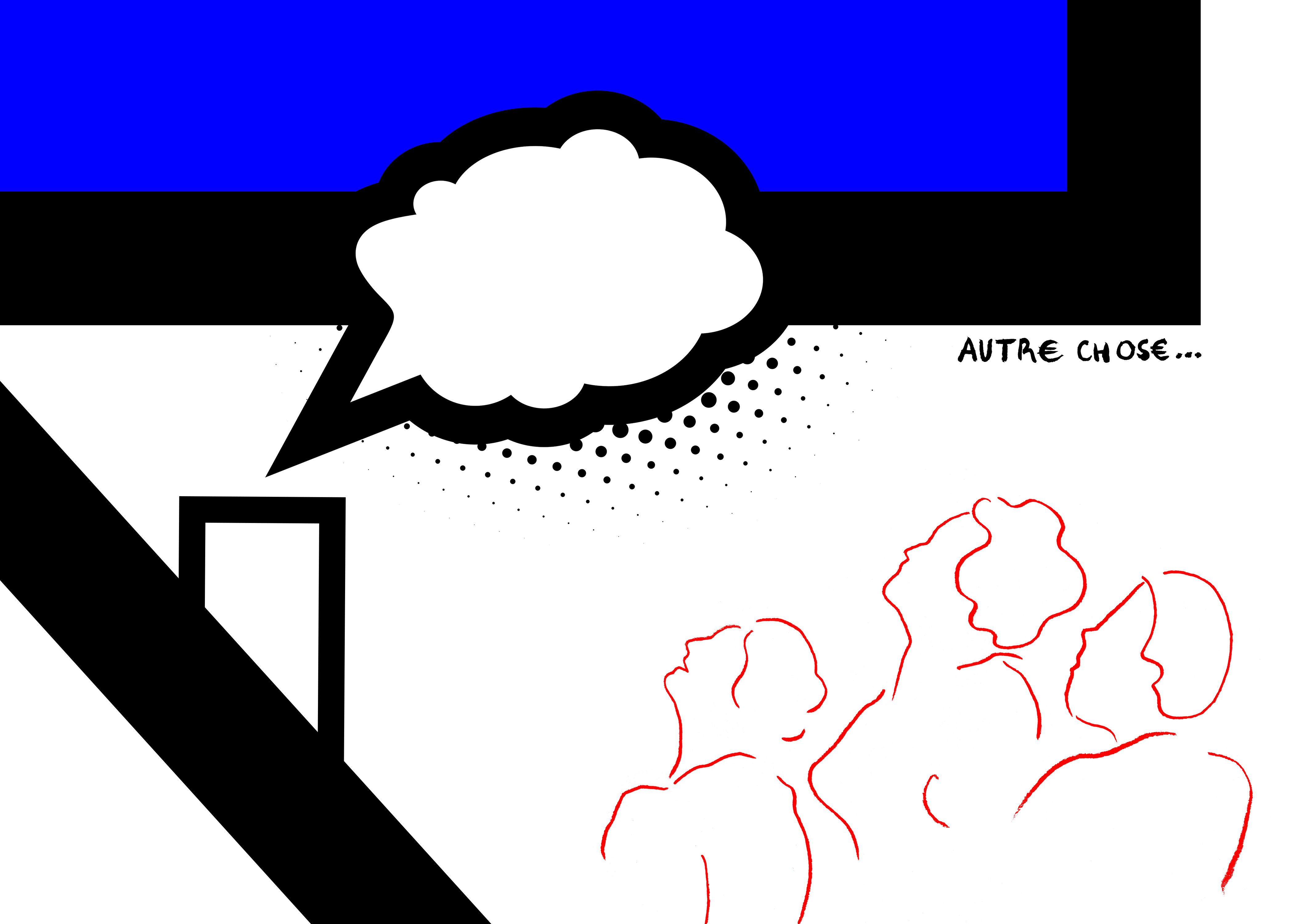
Les choix de couleur, de typographie et d’illustration des institutions culturelles ne sont jamais laissés au hasard. Ils sont bien évidemment cohérents avec le goût de la cible, mais ils doivent aussi contribuer à construire dans le temps une image mentale propre au lieu. Quand une personne décide de se rendre dans tel musée ou telle salle de spectacle, elle prend aussi en compte la place du lieu dans notre cartographie symbolique de la culture : notoriété, réputation, mais aussi valeurs portées, tendances actuelles et manière de se présenter. L’exemple du Palais de Tokyo permettra de clarifier ce point. Le lieu, situé dans le très chic 8e arrondissement de Paris, est parvenu en une dizaine d’années à se tailler une place de choix dans la sphère de la mode et des contre-cultures. Son positionnement stratégique est déjà audacieux : créations contemporaines, mêlant grands noms et jeunes artistes, à la croisée de la performance et de l’installation, multi-support et multimédia, basées sur l’exploitation des immenses espaces du lieu, de son caractère modulable et brut – pour ne pas dire vide. Le Palais de Tokyo s’offre ex nihilo à chaque artiste, et indirectement à chaque visiteur, se donnant ainsi une dimension de renouvellement permanent, mais aussi et paradoxalement une identité forte et stable, notamment auprès des jeunes avides de changement et d’anticonformisme. Son ouverture de midi à minuit, ses locations d’espace pour des défilés de mode ou des festivals, sa boite de nuit au sein du bâtiment qu’il occupe et sa communication iconique et ultra-épurée en font un archétype de ce qui peut marcher dans le futur du musée. Le Palais de Tokyo est devenu une véritable marque, qui véhicule un imaginaire propre dans l’esprit de ceux qui le connaissent.
La marque, en tant que signe distinctif, en tant qu’entité construite pour contenir du sens dans la désignation d’un produit ou d’un producteur, a cette force de résumer en un nom, une illustration, un ensemble de valeurs, de mots-clés et d’images mentales qui orientent notre choix de consommation. Pour le Palais de Tokyo, qui navigue entre Fashion Week, installations monumentales, clubbing et expérimentations sensorielles, le postulat est clair : s’affirmer en leader de la rupture, surprendre en permanence, refuser les codes et les repères, donc réfuter le passé comme modèle de référence. À l’extrême opposé, le Louvre lui aussi a réussi le pari de marque, mais sur le champ de la stabilité et de l’intemporel. On ne peut faire passer le Louvre pour quelque chose de moderne ou de tendance ; aussi la solution est d’assumer son statut quasi-divin et de le décliner comme un gage de qualité, loin des limites du monde matériel.
La dématérialisation du Louvre s’opère en trois temps. Le premier concerne la communication : le logo est simple, sur un fond de ciel noir et blanc évoquant à la fois le rapport à l’air de la pyramide (l’objet symbolique totémique du musée) et la sacralité de ce lieu multi-centenaire, la diffusion médiatique est minimale, la notoriété repose essentiellement sur la culture populaire et le tourisme. Le second concerne la diffusion de l’imaginaire : par les souvenirs achetés en boutique, par les partenariats de mécénat ou de sponsoring, et même – comble du luxe – par une station de métro dédiée (sur les quais de Louvre-Rivoli, des copies d’œuvre sont exposées dans une ambiance muséale somptueuse). Le troisième enfin repose sur l’exportation même du lieu : Louvre Lens et Louvre Abu Dabi entérinent le caractère mercantile du musée, ramènent le Louvre a une simple association entre un nom connu de tous et une collection d’œuvres devenues biens commerciaux, mais rappellent aussi ce rôle susmentionné de « gage de qualité » et de héraut de l’esthétique à la française.
Hétérotopies et fonctionnalités des lieux culturels

Ces modèles économiques sont des réalités efficaces et, quoi que l’on en dise, donnent une vie nouvelle et de grandes opportunités à ces lieux, historiques ou tout récents. Comme déjà dit, la multiplication des loisirs et la progression du numérique peuvent être un véritable piège pour des lieux qui, parce que lieux clos précisément, sont dépendants de murs, de barrières physiques et donc d’une véritable démarche d’entrée, de passage à l’acte. Parler de marque, c’est offrir la possibilité de sortir de ses murs, de dépasser l’immobilité et donc de capitaliser sur l’expérience, sur l’émotionnel plutôt que sur l’institutionnel. Le Guggenheim a parfaitement intégré cela car, en plus d’être intrinsèquement une marque et un lieu à la fois, le musée propose une expérience clairement identifiable, basée sur le nom, sur l’architecture et sur la réputation. On est bien loin des tableaux fixés aux murs devant lesquels on défile ; plus encore, les œuvres sont presque absentes de l’image mentale véhiculée par le musée. En cela, le rapport entre l’art et le lieu artistique est métaphorisé : on ne se rend pas dans tel lieu pour les œuvres en elles-mêmes, mais pour l’expérience, la plus-value sensible. À cheval entre le parc d’attraction intellectuel et le signe de distinction sociale, le musée-marque de demain doit tenir de la place que chacune et chacun donne à l’activité de loisir. L’enrichissement culturel n’est plus opposé au jeu ou à la distraction ; le tourisme devient multiforme et peut parfois s’éloigner des monuments les plus réputés ; les sorties scolaires prennent davantage en compte le goût des enfants ; enfin la découverte d’un nouveau lieu passe de plus en plus par les réseaux sociaux, la production de grands événements et les partenariats au gré des tendances.
Pour tout cela, le musée ou la salle de spectacle pousse encore plus la logique d’hétérotopie telle que la définit Michel Foucault. Ce lieu autre, à la fois lieu physique et ailleurs symbolique, vecteur des imaginaires culturels et invitations au voyage, vise avant tout à ne pas se satisfaire de ses limites physiques. L’institution culturelle, par la marque, sort de ses murs pour conquérir les esprits par une proposition d’expérience indépendante de la sphère matérielle. Les lieux, tout en investissant le virtuel, peuvent continuer à valoriser leurs espaces clos, mais en leur allouant des fonctionnalités, des rôles changeants, des potentiels sans cesse renouvelés. La polyvalence et l’adaptabilité, deux valeurs cardinales dans nos modes de consommation, doivent se sublimer dans l’expérience esthétique, car c’est là que les pratiques artistiques peuvent puiser de nouveaux modes d’expression, comme si le public inspirait indirectement les oeuvres qui lui seront proposées. C’est par un dialogue des imaginaires collectifs et des valeurs que la pratique du marketing peut sans doute être détournée de son rôle commercial, et saura se rendre plus acceptable aux yeux des lieux culturels. La marque, in fine, n’aurait alors d’autre fonction que de formaliser, dans un jargon économique, les univers et les émotions que nous offrent les musées et les salles de spectacle, d’en exploiter toute la valeur pour séduire une clientèle de plus en plus distraite et défiante vis-à-vis des institutions.